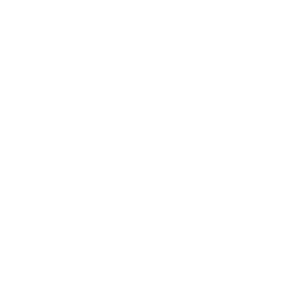En 1973, à Alger, un jeune étudiant de 28 ans, Hamid Cheriet (1945-2020), compose et enregistre une berceuse, enracinée dans l’âme de sa montagne. Celui qui choisira pour nom de scène Idir (« il vit ! », comme un impératif existentiel), ne se doute pas que sa chanson, A vava inou va, bouleversera sa vie. Les paroles sont signées d’un poète de 29 ans, Ben Hamadouche Mohamed alias Ben Mohamed. A Vava inou va vient de débouler sur la scène artistique algérienne et bientôt française, où des générations d’immigrés et de descendants d’immigrés mais aussi de Français pur sucre (ou pas) resteront marqués par la mélodie et la voix de l’artiste. A Vava inou va sera diffusée dans des dizaines de pays et traduite en une quinzaine de langues. En 1975, après avoir accompli ses obligations militaires[i], Idir s’installe en France et enregistre son premier 33 tours. Alors, « l’artiste naît marqué du sceau de la prédestination. Il ne choisit point sa vocation, sa vocation s’empare de lui et l’entraîne » cette phrase de Franz Liszt s’applique à merveille à la carrière d’Idir qui commence alors.
« Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir triché. Cela a dû créer une atmosphère entre moi et le public, un lien affectif très solide, indépendant des nouveautés ou des choses que l’on peut faire. Il y a aussi le fait que je suis né à une bonne époque et dans des circonstances tout à fait spéciales qui ont fortement imprégné la mémoire collective. Je n’y suis pour rien en tant qu’individu. En tant que symbole c’est peut-être ce qui a permis de garder le contact. »
(Idir, Tiddukla N° 3, 1985)
C’est la même année, en 1973, qu’Abdellah Mohia (1950-2004) débarque en France. Sous le pseudonyme de Muhend-u-Yehya, pour Mohia, il adaptera en tamaziɣt, des pans entiers du patrimoine littéraire mondial et, en 1974, il fonde sa première troupe de théâtre kabyle Imesdurar (Les Montagnards), composée d’étudiants dont Mustapha Bounab, Mustapha Aouchiche, Ramdane Achab, Boussad Benbelkacem, Saïd Boudaoud… C’est à Paris, dans l’émigration donc, que seront publiées les premières œuvres littéraires écrites en tamaziɣt, à commencer par Llem-ik ddu d udar-ik[ii]. « Dans cette dynamique de traduction littéraire, Muhend-u-Yehya occupe une place à part : par son ampleur, sa diversité et sa qualité, sa durée aussi, son œuvre peut être considérée comme une des grandes références fondatrices de la nouvelle littérature kabyle [iii]».
Toujours à Paris et toujours en1973, Djamel Allam (1947-2018) sort son premier album, Mara d yuɣal ; quatre autres garçons Sid Mohand Tahar (alias Karim Abranis), Shamy el Baz (Abdelkader Chemini), Samir Chabane et Madi Mahdi constituent, officiellement, le groupe Les Abranis et inventent un pop-rock à la sauce kabyle.
Le 29 janvier 1973[iv], l’université de Paris VIII-Vincennes décide la création d’un enseignement de langue berbère, sous l’impulsion d’étudiants algériens qui viennent de constituer, en mai-juin 1972, le Groupe d’Études Berbères (G.E.B), lequel publiera, de 1973 à 1977, 12 numéros de la revue Bulletin d’études berbères[v]. Au centre de cette initiative il y a un universitaire, exilé politique, et agrégé de langue arabe, M’Barek Redjala. L’époque est à l’arabisation et la répression : à Alger, les cours de tamaziɣt de Mouloud Mammeri sont arrêtés à la rentrée 1973, les manifestations sont violemment réprimées[vi], les intimidations se multiplient[vii] et les pressions du gouvernement algérien aboutissent à faire supprimer ce qu’il reste de l’émission en kabyle de Radio-Paris, « alors qu’historiquement il n’y a jamais eu autant de berbérophones en France » précise Ali Guenoun[viii]. Dans ce contexte, M’Barek Redjala publie dans deux revues parisiennes, deux textes importants en ce qu’ils abordent, pour la première fois, la question culturelle en termes politiques. Dans le premier[ix], il en appelle à l’enseignement du berbère et de l’arabe dialectal. « Nous devons accorder une place privilégiée à nos langues maternelles » écrit-il. Dans le second[x], il invite les Berbères à constituer un front uni, doté d’un programme pour l’institutionnalisation et l’usage de tamaziɣt et « faire admettre notre existence en tant que peuple ».
Lorsqu’Idir débarque au mitan de la décennie 70, cinq ans plus tôt le premier disque d’or a été remis à un artiste algérien, la grande voix de l’immigration kabyle, Slimane Azem[xi]. Mieux : l’ombre ardente d’une femme de convictions, pionnière du roman algérien de langue française, cantatrice et gardienne des chants kabyles, plane sur ces années. Taos Amrouche, puisqu’il s’agit d’elle, se produira au Théâtre de la Ville, justement en 1971 et en 1975.
Au même moment, en 1973, H’nifa s’en revient en France. Comme dans les années 50, H’nifa donne des concerts dans les cafés de l’immigration où elle chante l’exil au féminin, les femmes délaissées et le sort de celles restées au village. Femme, artiste et kabyle, H’nifa a cumulé les handicaps. En 1981, elle s’éteint, pauvre et anonyme, dans un hôtel parisien. Trois ans plus tôt, le 2 novembre 1978, elle partageait la scène de la Mutualité avec Slimane Azem et, comme un passage de témoin, le passage du temps, avec Idir, Ferhat et Matoub Lounès. En janvier de la même année, trois femmes chantent, en première partie d’Idir à l’Olympia, ce sont les Djurdjura.
Une génération sédimentaire
En 1979, à Paris, dans le quartier de Ménilmontant, un jeune animateur socioculturel, Chérif Benbouriche, alias Beben, enclenche, avec les Ateliers de culture berbère, une nouvelle forme d’expression kabyle au sein de l’immigration algérienne. Ces ateliers deviendront l’ACB, Association de culture berbère, trois ans plus tard, la première association des temps nouveaux, de ceux qui voient une jeunesse inscrire son être et son devenir en France tout en revendiquant une langue et une culture berbères, singulièrement kabyles. L’ACB va devoir apprendre à avancer entre héritages et « appel du large[xii] ». Symbolique est cette première semaine culturelle berbère organisée à partir du 19 mars 1979 à la MJC des Amandiers : M’Barek Redjala y donne une conférence et déjà, les chanteurs Idir et Ferhat, s’embarquent pour un long compagnonnage en soutenant l’initiative. Mohia, en électron libre, sera de cette aventure et viendra enregistrer ses adaptations et monter quelques unes de ses pièces à et avec l’ACB.
Le métissage s’enracine dans le même tuf, plonge tout aussi profondément, mais, en surface, il réclame plus d’envergure, plus d’horizontalité et plus d’horizon. Dans ce branle-bas tellurique des émotions et des appartenances, de nouvelles couches de sédimentations se forment.
Moment charnière
Idir, Djamel Allam, Djurdjura, Les Abranis, Aït Menguellet, Matoub et d’autres, celles et ceux que Kateb Yacine nommera « les maquisards de la chanson » porteront les aspirations culturelles, linguistiques, identitaires et démocratiques. Mohia inventera le théâtre kabyle et davantage encore. Le GEB, pépinière de militants et d’intellectuels engagés, renouvellera l’approche politique et culturelle de la question berbère en Algérie et en France. L’ACB inscrira de manière pérenne dans la géographie humaine et culturelle des migrations et de la société française cette part berbère sous estimée et sous représentée[xiii].
Tous appartiennent à une généalogie franco-algérienne qui ne gomme aucune de ses couleurs. L’important est l’inscription dans une trajectoire, la révision des historiographies officielles et sélectives, l’écriture d’un récit plus inclusif. De ce point de vue, la génération des années 70 est une génération d’héritiers mais aussi une fabrique à « bâtardises [xiv]» artistiques, culturelles, identitaires et politiques. « Comme un retour de l’histoire, le moment d’affirmation d’une chanson kabyle plus autonome, déliée des fondamentaux nationalistes qui avaient prévalus jusque-là, démarre dans l’immigration dans les années pré-printemps kabyle, soit les années 1970, fondée sur quasiment les mêmes thématiques que celles qui avaient eues cours dans les premières générations des immigrations, celles d’une valorisation de la culture de terroirs qui va s’élargir progressivement à celle du peuple kabyle sous l’influence d’un militantisme associatif d’autant plus actif qu’il s’inscrit dans un contexte de reconnaissance des différences. S’affirme et prend de l’ampleur alors toute une génération de jeunes chanteurs, nouveaux immigrés en rupture avec l’hégémonisme d’États autoritaires, où jeunes et moins jeunes, hommes et femmes issus des deuxièmes générations immigrés, qui vont tout en cherchant à intégrer les influences des musiques modernes, vouloir retrouver et restituer les cultures ancestrales, paysanne, villageoise, du terroir[xv] ». Et ce qui vaut pour la chanson kabyle vaut pour le théâtre et les associations culturelles.
« 1973 marque l’explosion de la musique dite « moderne ». Cela a été un boom. Les choses se sont très vite faites. Cela a duré à mon sens trois ans, après cela a été la décantation, le statu quo, les gens s’observaient en se grattant la tête d’un air de dire « et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? » Et depuis, plus rien ! »
(Idir, Tiddukla N° 3, 1985)
Les paris kabyles des années 70
De cette génération, Idir est devenu la figure, « l’ambassadeur ». Avec sa disparition, ce n’est pas un homme et un artiste qui s’absente, ce sont des pans entiers d’une histoire collective, portée par des femmes et des hommes d’exception. La voix et les mélodies d’Idir ont accompagné le quotidien, jusqu’aux moments les plus intimes, d’au moins deux générations devenues, ce 2 mai de l’année 2020, orphelines.
La « génération Idir », celle que Kateb Yacine surnomma « les maquisards de la chanson », ne gomme aucune des couleurs de l’histoire nationale algérienne, de l’immigration algérienne ou des Français d’origine algérienne. Bien au contraire, en dénonçant les historiographies officielles, amnésiques et assassines, elle ébauche un récit plus inclusif. 1973 pourrait être ce moment palimpseste où sous le texte du jour se devinent les mots d’hier, s’esquissent ceux de demain. Ces artistes, créateurs, militants politiques et associatifs du tournant des années 70, ont tenté – et légué – un triple pari.
« Notre âme »
Le premier tient à la survie d’une culture et d’une langue. « Notre âme » disait Idir. La question a été posée, dès 1967 par M’Barek Redjala[xvi]. En 1998, Salem Chaker en interrogeait les conditions dans un pays au nationalisme étroit et liberticide[xvii]. 50 ans après A vava inou va, malgré tous les succès et tous les efforts, elle est devenue crainte, motivée par la progression, en Kabylie même, de l’arabisation. Cette question de la survie ne concerne par les seuls usagers de tamaziɣt. L’enjeu est celui de la diversité culturelle, ce que l’Unesco appelle le « patrimoine commun de l’humanité » et que la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 vise à protéger. Sans cette diversité, point de choix ! Ne resteront que des « bouches cousues[xviii] » face aux discours monolithiques ; sans cette diversité point de pluralité des héritages et des identités, exit le souci de soi et la fabrique d’individus émancipés, les processus de métissage, le dialogue des cultures et la dynamique des processus « universalisant[xix] », exit l’« hybridité » chère à Taos Amrouche, c’est-à-dire l’« enrichissement mutuel des imaginaires[xx] ». Et puis… « quelle fête formidable on peut faire quand plusieurs têtes entre dans le jeu… Et quel paysage morose, aride, déprimant, quand il n’y en a qu’un qui pense ou qui fait semblant… un qui dicte ce que les autres doivent dire et penser[xxi]. »
« Sans cette culture je ne suis rien. »
(Idir, Actualités et culture berbères, n°29, 1999)
Ce qui est resté permanent pour moi, c’est mon attachement à mes premiers combats, c’est-à-dire celui de la libre disposition des gens et des pays, la souveraineté des peuples, et bien sûr le combat pour mon identité. Cette identité est aujourd’hui plus que jamais en danger et tant qu’elle sera menacée, je me battrai pour sa liberté d’exister. »
(Idir, Actualités et culture berbères, n° 56/57, 2007)
Parole droite
L’autre pari est celui de la parole droite – conforme à cette éthique qui loue, traditionnellement, en Kabylie la parole appropriée, juste, ciselée. C’est d’ailleurs une caractéristique du « style » Idir : parler avec simplicité, utiliser le registre de l’émotion comme porte d’entrée à l’intelligence. C’est cette parole droite qu’ont recherchée et portée ces deux figures débarquées en 1973, l’un avec une chanson, l’autre physiquement. Idir et Muhend-u-Yehya ont toujours évité deux écueils : celui de l’identitaire absolutiste (essentialiste, fermée et accusateur) et celui qui dissout ce qu’Idir nommait « notre âme » dans un universalisme de moraline. Pour Idir comme pour Mohia l’inscription dans un universel partagé ne pouvait se faire sur le dos de leur langue et culture – comme semblent l’oublier, depuis le décès d’Idir, les « sentimenteux [xxii]», louangeurs d’un universalisme à bon compte, aveugles ou complaisants quant aux rapports de domination. Le poète et le chanteur retrouvent Taos Amrouche qui, par son sacerdoce au service de sa langue et de sa culture, entendait bien œuvrer au « rapprochement entre les peuples[xxiii] ».
Il en est de la revendication identitaire comme de la place des femmes pendant la Guerre de Libération : à force d’être reportées au nom d’intérêts dits supérieurs (hier l’Indépendance, aujourd’hui l’universel), ce sont les populations berbérophones et les femmes qui trinquent. La culture et les femmes ! Idir fut peut-être celui qui, plus que quiconque au sein de la nébuleuse berbère, insista, par ses chansons et ses prises de position, pour mener ensemble et faire converger ces deux combats. Idir a chanté la femme, toutes les femmes : mère, fille, sœur, femmes délaissées, opprimées, seules ou silencieuses … « Vis à vis d’une femme en général, d’une maman en particulier, nous avons tous quelque chose à nous faire pardonner, à tout le moins, à nous reprocher » disait-t-il lors de ce concert donné à Puteaux le 6 novembre 2004 (et disponible sur Youtube). La parole juste : marcher sur ses deux pieds, la langue et les femmes ! La première ne peut être dissoute dans un universalisme de pacotille ni affaiblie par quelques vociférations sans lendemain. Quant aux secondes, aucune cause ne peut être invoquer pour justifier qu’il faudrait remettre à demain l’exigence d’égalité et de dignité.
« Je peux être Kabyle partout, à Los Angeles ou à Bogota ou ailleurs à partir du moment où ma langue est ancrée dans mon âme, comme la poésie kabyle. Je porte cette culture des anciens, les traditions dont j’ai hérité. En vérité, je me suis débarrassé de quelques-unes… (…) Je me suis débarrassé des traditions qui préconisent le sexisme ainsi que de celles qui s’apparentent au communautarisme… Cela fait longtemps que j’ai jeté ces notions par la fenêtre, comme dans la religion d’ailleurs. »
(Idir, Actualités et culture berbères, n° 56/57, 2007)
Un champ rhizomique
Enfin, troisième et dernier pari de cette génération : en finir avec la logique du binaire, celle qui oppose arabophones et berbérophones, et que le mouvement culturel et associatif, dans ces années 70, a voulu dépasser – par les notions de « langues populaires » ou « maternelles » notamment. Ils ont labouré un champ des possibles, émancipé des nationalismes étroits et des « identités meurtrières », où le multiple et l’arc en ciel des couleurs pourraient se déployer. « Enfants de mon pays, je vous ai vus courir ensemble sur la plage, libérés de nos races et libérés du sang[xxiv] » écrivait Jean Sénac, assassiné à Alger en… 1973. Un champ de rhizomes où, à la verticalité des origines, Idir a ajouté l’horizontalité de la relation. Cette voie est un chemin difficile, un de ceux « qui montent[xxv] » et Idir en savait quelque chose pour avoir subi les reproches de quelques énergumènes, qui lui reprochaient d’avoir chanté avec Khaled en 1995.
« J’ai vite compris que le combat berbère seul était moins viable s’il n’était pas rattaché à toutes les injustices que subissait le peuple et que si nous n’étions pas tous berbères, des choses nous unissaient. Un Tlemcénien faisait comme un Kabyle la chaîne pour obtenir quelques denrées alimentaires. C’est ainsi que j’ai été persuadé que nous ne pouvions pas défendre notre identité sans combattre toutes les injustices commises par le pouvoir central qui opprimait sans cesse son peuple. Il fallait donc combattre l’oppression dans sa globalité et pouvoir ainsi revendiquer encore plus fort notre identité. »
(Idir, Actualités et culture berbères, n° 56/57, 2007)
C’est cette voie qu’à ouverte Idir. Une voie qui reste à explorer. En 1968, Kateb Yacine en avait déjà et admirablement dessiné les incertains contours dans sa préface au livre de Fadhma Ath Mansour Amrouche, Histoire de ma vie : « Le livre de Fadhma porte l’appel de la tribu, une tribu comme la mienne, la nôtre, devrais-je dire, une tribu plurielle et pourtant singulière, exposée à tous les courants et cependant irréductible, où s’affrontent sans cesse l’Orient et l’Occident, l’Algérie et la France, la Croix et le Croissant, l’Arabe et le Berbère, la montagne et le Sahara, le Maghreb et l’Afrique, et bien d’autres choses encore : la tribu de Rimbaud et de Si Mohand ou M’hand, d’Hannibal, d’Ibn Khaldoun et de Saint Augustin, un arbre de Jouvence inconnu des civilisés, piètres connaisseurs de tout acabit qui se sont tous piqués à cette figue de Barbarie, la famille Amrouche ». Tels étaient – et demeurent – les paris kabyles des années 70. Les paris d’Idir : « Dis ce que tu veux, nous sommes derrière toi[xxvi] ». Mais, il va falloir être à la hauteur.
« Ce qui est évident, c’est que cette culture dans cet espace et aussi loin que l’on se souvienne, est l’une des premières. Il est donc tout à fait normal qu’elle soit non seulement reconnue, mais reconnue comme étant la culture première de cette terre. Quand on me dit qu’idéologiquement, l’arabe est la langue nationale et officielle et que l’on va se pencher sur les autres… je ne suis pas d’accord. J’ai mon identité propre et je sais que j’appartiens à une culture et à une civilisation qui sont là depuis la nuit des temps. Je n’ai pas à apporter la preuve de ma culture et de mon identité, c’est plutôt aux autres d’apporter la preuve de la leur. Chronologiquement, j’étais là le premier, s’il devait y avoir une première langue nationale rattachée à cette terre, à cet espace géographique, serait la mienne. Je n’en suis plus à revendiquer une permission d’exister. J’existe et je le sais en moi. C’est aux autres de m’apporter la preuve de leur existence et surtout de la vérité de leur identité. »
(Idir, Actualités et culture berbères, n°29, 1999)
« Être kabyle c’est une chose, c’est bien mais ni pire ni meilleur qu’une autre. Mais être kabyle et apporter des choses à l’universel c’est mieux. Être les deux, c’est formidable ».
(Idir, Actualités et culture berbères, n°29, 1999)
NOTES
[i] « Le jeune homme qu’il a été n’a pas cherché à échapper aux deux années de service national en dépit des griefs qu’il avait contre le régime algérien alors que, de surcroît, à ce moment précis, s’ouvrait devant lui une carrière artistique prometteuse » écrit Hend Sadi dans le quotidien algérien Liberté du 11 mai 2020.
[ii] Abdallah (Muhend u Yehya) MOHIA (Mohya), Llem-ik ddu d udar-ik. Adaptation de L’exception et la règle de B.Brecht, Paris, Tizrigin Tala, 1974.
[iii] Salem Chaker, « Littérature berbère, la naissance d’une littérature écrite », in http://www.tamazgha.fr/La-naissance-d-une-littérature-écrite, 1086.html, Paris, publié le lundi, 13/12/2004, site consulté le 15/05/2020].
[iv] Ali Guenoun, Chronologie du mouvement berbère, un combat et des hommes, éditions Casbah, Alger, 1999.
[v] Réédités par les éditions Achab en Algérie, en 2016 sous le titre Bulletins d’études berbères – Numéros 1 à 12, 1973 à 1977. Préface de Lionel Galand. Voir pour une présentation détaillé le site du quotidien en ligne Le Matin : https://www.lematindz.net/news/20342-document-groupe-detudes-berberes-universite-paris-viii-vincennes.html.
[vi] Comme à Larba n ath Iraten, en juin 1974, lors de la traditionnelle Fête des crises.
[vii] Il suffisait pour un immigré d’être abonné à la revue de l’Académie berbère ou de simplement fréquenter cette association pour être arrêté.
[viii] Ali Guenoun, op.cit.
[ix] M’Barek Redjala, « Remarques sur les problèmes linguistiques en Algérie », L’homme et la société, 28, pp. 161-177(1973).
[x] M’Barek Redjala, « Spécificité culturelle et unité politique », Les Temps modernes, n » 323, juillet, 1973, pp. 2242-2252.
[xi] Où l’on retrouve Muhend-u-Yehya qui a rassemblé et traduit quelques uns des poèmes du « maître » : Slimane Azem, IZLAN : Recueil de chants kabyles. Paris Numidie Musique. 184 pages.
[xii] Titre d’un poème de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du mal.
[xiii] Voilà des populations sensées porter la deuxième langue de France après le français qui ne peuvent se prévaloir d’aucune institution d’envergure nationale, d’aucune radio, d’aucune grande messe annuelle où viendrait se presser le gratin politique et institutionnel. C’est Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France qui, le 8 juin 2016, sur Berbère Télévision rappelait la place de la langue berbère dans la société française. A voir sur : https://www.youtube.com/watch?v=TpIvofsAaBM&fbclid=IwAR3CcXBvUS6Ozi_XEcBQ9geH-Tji4FA4duVW6rSKpMh7QpZq9i8qGAhjNNo
[xiv] « Si notre présent est le fils du passé, notre passé est le fils du présent. Et l’avenir sera le moissonneur de nos bâtardises » ; Amin Maalouf, Origines, Paris, Grasset, 2004.
[xv] Aïssa Kadri, Chansons kabyles d’exils, Etudes et Documents berbères 2013/1 ; N°32 pp. 7 -11.
[xvi] Dans une lettre adressée à Hocine Aït Ahmed.
[xvii] Salem Chaker, Berbères aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 1998.
[xviii] Formule empreintée à Kateb Yacine, dans sa préface au livre de Fadhma Ath Mansour Amrouche, Histoire de ma vie, Paris, Maspéro, 1968.
[xix] F. Jullien, De l’universel : de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Paris, Fayard, 2008. Pour le compte-rendu voir, M. Harzoune in Hommes & migrations, 1277 | 2009, 144-146.
[xx] Akila Kizzi, Marie-Louise Taos Amrouche, Passions et déchirements identitaires, Paris, Fauves Editions, 2019, p.147.
[xxi] Mouloud Mammeri, Entretien avec Tahar Djaout, suivi de : La cité du soleil (inédit), Laphomic, Collection Itinéraires, Alger, 1987
[xxii] Mot de Gustave Flaubert rapporté par l’historien Henri Guillemin dans sa conférence du 17/06/1957 « Flaubert tel qu’il fut ». Archive INA-Radio France choisie par Fabrice Luchini à l’occasion de sa « Nuit rêvée » avec Philippe Garbit sur France Culture le 26 janvier 2014. A consulter : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-de-fabrice-luchini
[xxiii] Taos Amrouche, Solitude ma mère, Paris, éd. Joëlle Losfelf, 1995, p.299
[xxiv] Jean Sénac, Œuvres poétiques. Préface de René de Ceccaty. Postface de Hamid Nacer-Khodja, Actes Sud 2019.
[xxv] Double référence ici : au dicton kabyle (« ansi is tkid i Larva, d asawen » soit « Pour rejoindre Larbaâ (Nath Irathen) les chemins sont fort nombreux ; on a beau choisi le sien, ce sont des chemins qui montent » et bien sûr au roman de Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, Paris, Le Seuil, 1957.
[xxvi] Yusef u Kaci est le « poète national, du XVIIIe siècle » (Mouloud Mammeri). Poète il était aussi investi d’« un rôle d’ambassadeur, d’un rôle politique ». Mouloud Mammeri rapporte qu’au cours d’une affaire opposant Turcs et At Djenad, il demanda aux At Djenad « qu’est-ce que je vais dire au caïd Turcs ? » Les gens lui dirent : « dis ce que tu veux, nous sommes derrière toi ». Ceci pour dire l’autorité dont il était investi…