LIVRE
Après Dieu de Richard Malka
« Il est temps d’enseigner que le vrai sacrilège, c’est de préférer la servitude à la liberté »
Richard Malka est avocat, essayiste, romancier et scénariste de bandes dessinées. Il débute sa carrière à 23 ans au sein de l’ancien cabinet de Georges Kiejman, devenu ministre. Il assure notamment la défense de Charlie Hebdo depuis sa création en 1992. Ses interventions dans le débat public portent sur la défense de la liberté d’expression et de la laïcité (Prix national de la laïcité 2020). Comme romancier et essayiste, il est l’auteur de Tyrannie (Grasset), d’Éloge de l’irrévérence, avec Georges Kiejman (prix international de Revue trimestrielle des droits de l’homme), du Voleur d’amour (Grasset), du Droit d’emmerder Dieu (Prix du livre politique, Prix des députés 2022 et Prix du Meilleur essai des éditions Portraits 2023) et de Traité sur l’intolérance (Prix du livre politique du Barreau de Paris 2023). Il est aussi scénariste de bandes dessinées.
Dans Après Dieu il écrit : « Il est temps d’enseigner que le vrai sacrilège, c’est de préférer la servitude à la liberté et que la pire des offenses à l’égard de la création consiste à en rejeter les infinies possibilités de liens, d’amour, de débats, de rire, de réflexions, d’échanges et de plaisir qui nous sont offertes ». Voilà pour le ton et l’esprit. L’objectif ici n’est pas de se construire un ennemi mais de protéger notre « pulsion de vie ».
Selon le principe de la collection, Richard Malka a choisi de passer une nuit au Panthéon pour, dans un dialogue imaginaire, s’entretenir avec « l’anticlérical, le pourfendeur de l’infâme religion », à savoir Voltaire qui, par les tristes temps qui courent, serait « un homme mort avec [ses] diatribes sur la religion », moins du fait de persécutions étatiques que de l’action et des prétentions des tribus et autres communautés qui veulent faire la loi, imposer un totalitarisme de rue et de cité, de réseaux et de prêches : « l’idée communautaire est l’ennemie de la libre conscience et de l’universalité. ». A l’heure où en France des enseignants sont agressés ou décapités, Malka demande à Voltaire : « Quel combat faut-il mener pour cesser de préférer l’esclavage à la liberté ? ». Non sans émotions et désarroi, il décrit l’« insupportable » régression, la marche à reculons du monde, jusqu’à suggérer un possible échec annoncé. Pour autant, Richard Malka refuse de « baisser les armes » : « se résigner, c’est déjà mourir ».
Dans le collimateur de l’avocat, il y a cette gauche qui « par peur d’être qualifié[e] d’islamophobe (…) s’est soumise au fascisme religieux ». Avec justesse, il pointe ce paternalisme qui veut qu’« un musulman ne peut être qu’une victime et, pire, un pieux croyant discipliné ou une femme voilée. Il faudrait donc défendre cette religion même quand elle se fait tyrannie ». Il rappelle, ce qu’il faut répéter encore et toujours, que « les musulmans sont les premiers à vivre sous cette terreur ». À propos de cette gauche, il demande à Voltaire de « réveiller leur goût de défier les dieux plutôt que de plier les genoux devant l’un d’eux sous prétexte de ne pas froisser ses ouailles ». Et de rappeler, ce qui rehausse l’argumentaire de considérations éthiques, que le philosophe des Lumières détestait « les donneurs de leçons ». Pour lui, « la vertu était le ressort principal de la tyrannie ».
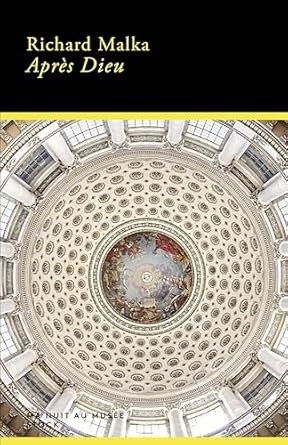
Dans la dialectique du peuple et des élites, les élites sont décrites ici comme pusillanimes, du moins celles qui reprochent aux morts leurs dessins ou leur enseignement et discourent à longueur de tribunes « sur les méfaits de la laïcité », jusqu’à ergoter sur le droit au blasphème. Alors que « le peuple tient bon contre ces fripons ».
Face à l’hystérie religieuse et identitaire, « seule la fermeté garantit la paix » écrit Malka. Avec des accents à la Boualem Sansal, il affirme que « l’humanisme est un combat, non une complaisance » et qu’« il n’y a rien à gagner à être modéré ». Avec Condorcet, il invite à « ne pas céder à l’école » ; ne pas céder sur la vision universaliste des Lumières ; sur les identités plurielles et permettre qu’elles s’épanouissent en harmonie. Parce que « l’identité mène à l’identique », il conviendrait aussi de promouvoir « le droit à l’indifférence de ses différences » et de se détourner des « périls de la notion pervertie de respect » qui devrait être dû aux religions. Il faudrait aussi dire que non seulement il y a un « continuum » entre islam et islamisme mais que « l’islamisme est en train d’absorber l’islam ». Si le voile est un sujet complexe (ce qu’il montre), il n’en reste pas moins que sur le fond, il est « un emblème antirépublicain, une résistance à la laïcité encouragée par les prédicateurs radicaux et les sites de propagande financés par le Qatar ».
Enfin, statistiques et sondages étatsuniens à l’appui, il montre que « la foi n’est pas synonyme de vertu » : « plus la famille est religieuse, moins l’enfant est altruiste » et, en matière de violences conjugales, « la violence faite aux femmes par la religion est plus systémique qu’aucune autre et pourtant ce n’est pas celle qui est le plus souvent dénoncée, loin de là ».
Pour autant, tout cela ne suffit pas… il faut remplacer Dieu ! Encore et toujours Voltaire. Convoquant Jaurès, Zola ou Hugo, il quête une autre « transcendance », l’invention d’un récit commun – rappelant les dernières pages de L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni. Avec Hugo, il cherche du côté de la littérature, convoque les « Lumières voltairiennes » d’où est sorti cet « embryon de civilisation universaliste, laïque, rationaliste ». Il faut « renouer avec une ambition pour l’humanité, une dialectique offensive de la liberté, une rage de convaincre le monde de la justesse de l’idée laïque », partant, rechercher « une autre transcendance » et renouer avec notre « pulsion de vie ».
Richard Malka, Après Dieu, Stock 2025, 150 p., 19.50 €.
MH
Richard Malka présentera son livre à l’ACB (et en direct FB)
le mercredi 5 novembre à 19h00.

