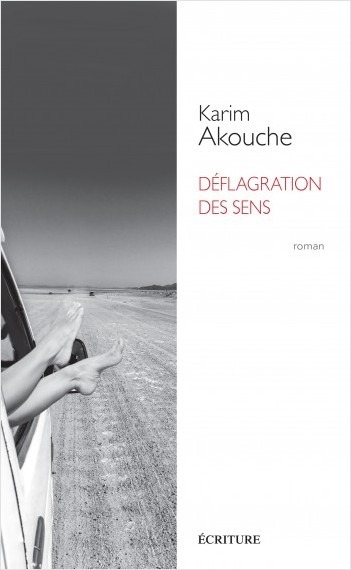pour éviter d’étouffer
Une fois de plus, il ne faudrait pas se tromper. Karim Akouche – comme Sansal, Daoud ou Cherfi – risque, malgré lui, de devenir le carburant siphonné à gogo par des chauffards de la pensée. Tandis que les uns pétaradent, d’autres l’accusent de servir la soupe. Bien malgré eux, des écrivains se retrouvent détournés, instrumentalisés, et des œuvres abandonnées dans le caniveau des tribunes de circonstance ; après avoir été salies par des obsessions monomaniaques déguisées en « pensée ». La littérature, puisque c’est d’abord de cela qu’il s’agit – « Une tâche impossible m’occupe, sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire » écrit Tassadit Imache – est travestie en étendard ! Un égrugeoir où tout se réduit en une même et exclusive bouillie sur une réalité pourtant kaléidoscopique. Et les thèmes, par ces auteurs portés, ne manquent pas : immigration, islamisme, islam, terrorisme, colonialisme et postcolonialisme, indépendances et Histoire, féminisme, voile, mémoires, discriminations, ressentiment, victimisation, tout y passe. Sans oublier, puisque Karim Akouche est un digne rejeton du Djurdjura, la question de l’identité algérienne, exclusive et hors sol. Les sujets se bousculent, l’embouteillage guète.
Pourtant, malgré la vigueur et la teneur de ses propos, Karim Akouche est un poète. Et sa poésie a plus à offrir au monde – à ses lecteurs à tout le moins – que ses prises de positions, fussent-elles courageuses. Les mots, le souffle, le vitalisme tout terrain, la soif inextinguible d’amour et de liberté tout cela, et plus encore, forment le meilleur et le plus fécond des viatiques : « tout est là, caché entre les dents fragiles des poètes, tout dégouline des doigts des peintres maudits » comme il l’écrit lui-même. Mieux vaut « divaguer » avec les poètes que de marcher au pas de la rationalité ou de l’espérance eschatologique.
Kâmal Sûtra, al Pacino du Djurdjura
Déflagration des sens, le troisième roman de Karim Akouche, forme un long monologue, une longue tirade débitée d’une traite par « notre » narrateur « en colère » ; un flot (ou flow) comme un trop plein déversé urgemment ; une nécessité vitale de témoigner – d’être enregistré ! – pour dire les soirs qui tombent et les aubes à venir. Un road novel qui emmène son lecteur en direction du Sahara. Le narrateur se fait appeler Kâmal Sûtra. Cet « al Pacino du Djurdjura » est né en Kabylie. Il y a connu une enfance sans père – « papa forniquait en France avec sa deuxième femme ». Il s’est construit grâce à la sagesse traditionnelle du coin, par sa mère transmise, plutôt que par les élucubrations religieuses, par l’école répandues. Plus tard, il s’est essayé au journalisme, ce « métier de putassiers mal fourrés » mais, comme « derrière chaque ligne se cache un homme en képi ou en cravate », il a vite décampé.
On le retrouve sans papiers en France puis en Espagne avant de revenir – d’être réexpédié fissa – dans son cher pays. Là, il transforme son fourgon Benz en véhicule de transport, avant de nourrir l’espoir de prospérer ; et de servir le bien public – « qu’on laisse les jeunes se tripoter librement ! » – en métamorphosant sa teutonne patache en un affriolant… bordel ambulant.
Le sexe ! Il est omniprésent. Servi à toutes les sauces, dans toutes les positions, pour tous les goûts et les désirs, toutes les espérances. Le sexe ici est autant gymnastique des corps, qu’idéal platonique. Il est ce non dit qui nimbe regards et effleurements ; cette absence qui affole les âmes prisonnières, ce silence à vous taper la tête contre les murs qui fait les vies tristes. Et les sociétés mortes ! Comme l’écrivait Maïssa Bey : « comment toute une société peut-elle fonctionner et s’organiser en faisant totalement l’impasse sur un sentiment aussi essentiel, aussi beau que l’amour ?[i] ».
Le dire, comment l’entendez-vous ?
44 ans et toujours puceau ! Diagnostic imparable. Sur l’homme et sa société. Le « On ne peut pas réfléchir les couilles pleines » qui ouvre ce roman jubilatoire annonce la couleur : la dialectique du dire et de l’entendement. Provocation ? Non ! Plutôt procédé romanesque, maïeutique du verbe et du sens – non pas des sens – poussée jusqu’à ses limites pour accoucher de ce terrible constat : Homme infécond. Indépendance inféconde. Pays infécond. Un Tropique du cancer à la sauce algérienne ! On est loin ici des galipettes – réelles ou fantasmées – de Kâmal Sûtra. « Il fait chaud et mes lèvres réclament des baisers. Redonne-moi une autre bière. J’ai besoin de déboucher mes artères. Elles sont obstruées par toutes sortes de dogmes. On m’a dit enfant de ne pas parler devant les adultes, de respecter les aînés. On m’a dit de me fondre dans la masse, camarade, de ne pas faire de vagues. On m’a dit des choses et des conneries, de prier et de chanter l’éloge de nos prédécesseurs. Tant d’ordres et d’interdits entassés dans mon sang et ma graisse… Je suis à la fois lourd et vide. J’ai un diable au corps et un idiot dans le cerveau. »
Il ne faudrait donc pas se laisser abuser – ou amuser – par le ton, la langue de Karim Akouche. Derrière le brio des formules et des aphorismes, l’art récréatif de l’insulte et de l’érotique, derrière la légèreté rabelaisienne et le poids du blasphème, l’auteur déploie réflexions philosophiques et références littéraires (la liste des auteurs cités serait trop longue).
« Oui les mots sauvent, libèrent, mais ils peuvent aussi blesser et tuer » dit notre héros. Un livre, en particulier, a sauvé notre homme : Jonathan Livingston le goéland, de Richard Bach. La littérature ne change peut-être pas le monde, mais la vie du lecteur, surement ! Traduction du monde ou de combat, polysémique ou émerveillement, la littérature est aussi consolatrice, résiliente. Déjà Montesquieu écrivait : « je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé». Eloge donc du livre et des mots et dénonciation vigoureuse des salissures idéologiques, politiques, publicitaires et autres ; « Lave les mots traînés dans la boue /et les bouches putrides » dit le poète Abdellatif Laabi[ii].
Petite philo de l’Histoire
Déflagration des sens est aussi un hymne dionysiaque à la vie ; exit ici « la morale et ses mièvreries », exit l’espérance, exit aussi le ressentiment : « Arrête de remuer le passé, camarade. Tu n’as pas le droit d’accuser les Français d’aujourd’hui des crimes commis hier par leurs aïeux. Sors du complexe du colonisé, sois adulte et responsable. Quitte la fourrure du ressentiment. » Pourquoi ? Pas pour satisfaire le bourreau mais pour abandonner « définitivement [la] posture de victime ». Et ce « lâcher prise » tient plus à sa kabyle de mère qu’au maître Lao Tseu : « Ma mère, la veille de mon départ pour Paris, m’a averti : « La France a détruit ma famille, mais pas la tienne. N’y va pas avec des idées perverses dans le cœur, mais avec la tête pleine d’idées fraiches et des rêves flamboyants. Pardonne et n’oublie point, mon fils… » On pense ici à quelques lignes de l’autobiographie d’Arezki Idjerouidene[iii].
Qu’en est-il alors du rapport à l’Histoire et aux morts ? Peut-être s’agit-il, sans forligner, de rétablir l’équilibre : « Nous aimons nos morts plus que nos vivants » fait dire en 2020 l’auteur à son héros. Cela rappelle les vers d’Ahmed Azzegah : « Arrêtez de célébrer les massacres / Arrêtez de célébrer des noms / Arrêtez de célébrer les fantômes / Arrêtez de célébrer les dates / Arrêtez de célébrer l’Histoire / La jeunesse trop jeune à votre goût / insouciante et consciente / Sait. (…) Et les enfants d’aujourd’hui / Et ceux qui naîtront demain /Ne vous demandent rien / laissez-nous laissez-les vivre / En paix / Sur cet îlot de l’univers / L’univers seule patrie[iv]. » des vers qui datent de… 1966 ! Ou ceux de l’écrivain et journaliste Mustapha Benfodil, « Les mots, pas les morts[v] ».
Logiquement, dans cette brouillonne philosophie de l’Histoire, notre Kamel Sûtra revisite la dialectique du maitre et de l’esclave. Il en appelle à La Boétie et sa servitude volontaire pour rayer postures victimaires et autres lamentations sur l’islamophobie (voir p.84 et 85). Mais « Comment m’aimer au lieu de détester les autres ? Arrête de dire que tu n’es pas l’autre et dis qui tu es vraiment. La négation vide le sujet de sa substance et en fait un bâtard. « Je » est toi, l’autre est un étranger à ton être. Affirme-toi avec tes mots et tes couleurs, camarade… ». Partant, « nous sommes le cœur du Système pourri ». Rien moins ! A sa rescousse, il convoque Invictus, le poème cher à Mandela, écrit par William Ernest Henley : « Aussi étroit soit le chemin, / Bien qu’on m’accuse et qu’on me blâme, /Je suis le maître de mon destin, /Le capitaine de mon âme ». Voilà qui entre peut-être en résonnance avec cette citation placée en ouverture du roman : « Avant de faire la révolution, réforme ton cœur ». Car le « chacun est assassin à sa manière » sonne comme la contrepartie de la nécessité de « reformer son cœur ».
Consolons nous, ce long monologue philosophico-littéraire, socio-politique, individualo-collectif est aussi un éloge du rire – « le rire libère les morts de leurs péchés, tandis que le sérieux les constipe ». Quant aux vivants, ce conseil : « Au lieu de pleurer, rions de nos échecs » – qui rappelle Rabbi Nahman de Bratslav, « Plus les temps seront durs, plus notre rire sera fort ». Notre « Al Pacino du Djurdjura » dresse pour son lecteur/auditeur un éloge de la vie et, « dans un monde qui meurt d’un trop plein de sérieux » en appelle à l’ivresse baudelairienne ou à la folie d’un Kerouac. « Chantons et dansons », célébrons « le bordel de la vie » clame ce musicien qui se revendique « manouche berbère » – curieux métissage aux accents d’oxymore.
Cash !
Le style est sans concession, sans simagrées ni danses du ventre. Trash est la phrase, cash le propos, et vive le clash ! « Ma langue crachera du venin, camarade. Elle ne tuera pas, mais elle empoisonnera les petites âmes… » Haro donc sur les moralisateurs, les « sentimenteurs » et les romantiques : « Les valeurs ? Les principes ? La morale ? La justice ? La vérité ? La liberté ? Juste de grands mots qui n’existent que dans le lexique pour les idiots… ». Plutôt Cioran puisqu’il faut « dire des choses dures pour éviter d’étouffer vainement ». Petit florilège :
L’islamisme ? « Les versets du djihad ne sont pas tombés du ciel, camarade. Ils se trouvent dans le Coran et les hadiths. L’islam est malade, les racines de la violence sont dans le texte. Ne me censure pas, laisse-moi jaboter. L’islamisme est le vrai visage de l’islam, du moins son avatar incandescent. C’est comme l’eau et la vapeur, ce qui diffère, c’est seulement la température (…) l’islamisme, c’est l’islam en ébullition. L’islam, c’est l’islamisme mis au frigo. (…) Je rêve d’une version abrégée du Coran où les sourates violentes auraient été expurgées. » De la nécessité de l’ijtihad défendu en son temps par Mohamed Arkoun ou de cette relecture du Coran entreprise par Youssef Seddik[vi].
L’Algérie ? « L’Algérie est une maison close, les décideurs sont des proxénètes, le peuple est un cheptel de moukères, les militaires et leurs amis intégristes fourrent le peuple depuis l’Indépendance. » Et : « notre soif de violence vient-elle de notre mépris du savoir ? Au lieu de bâtir des bibliothèques, on érige des mosquées. » Terrible résonnance avec l’actualité…
Les femmes ? « Comme beaucoup d’Algériens qui bombent le torse, je suis un assisté. Les femmes travaillent à la maison, les hommes jouent dehors aux cartes ».
Tamazight ? « Si tu veux dominer un peuple, fais-lui oublier ses racines (…) Si tu veux l’assimiler, dis-lui que sa langue est un idiome, sa culture du folklore, sa patrie l’univers. Si tu veux le faire disparaître, et si tu ne peux pas l’exterminer physiquement, colonise sa mémoire et emplis son Histoire de héros imaginaires… ». Quant à « L’école algérienne [qui] voulait faire de moi un croyant, domptable à souhait, un soumis. Raté camarade. J’ai résisté avec mes moyens et, surtout, grâce à la chanson kabyle engagé et aux valeurs de mes ancêtres ».
Mondialisation ? « L’Histoire est fatiguée, elle a des cernes et des rides. Le monde se globalise et les êtres deviennent fades. L’uniformisation est une sorte de fascisme camarade. J’aime la différence, moi, le jeu des lumières (…) ». Cet l’éloge du divers traduit-il une position philosophique ou la condition d’un écrivain, d’un citoyen porteur d’une langue et d’une culture minorée dans son propre pays, menacé par une autre uniformisation ? Les deux sans doute.
Ce roman, jubilatoire dans sa forme, réussit son pari : provoquer une déflagration de sens.
Mustapha Harzoune
[su_row][su_column size= »1/3″]
[su_row][su_column size= »1/3″]
Karim Akouche, Déflagration des sens, Ecritures 2020, 197 pages, 18 €.
[i] Bleu blanc vert, l’Aube, 2006.
[ii] L’Étreinte du monde, La Différence, 1993
[iii] Monsieur Arezki, Un destin à tire d’aile, Paris-Méditerranée, 2018
[iv] Jean Sénac, Anthologie de la nouvelle poésie algérienne. Poésie 1, n°14, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1971
[v] Archéologie du chaos (amoureux), Al Dante, 2012
[vi] Le Coran, Autre lecture, autre traduction, par Youssef Seddik, éd. Barzakh & éd. de l’Aube, 2002
Ecoutez l’entretien de Karim Akouche
avec Lydia Aït Bouziad et Mustapha Harzoune :
Ici :
Déflagration des sens est disponible en librairie
Vous pouvez le commander chez notre partenaire
Librairie « La Maronite »
35 rue des Maronites 75020 Paris – 01 77 18 82 25